
Dans ce tube
Le regard pétillant, je te regardais jouer avec les mots comme on joue avec des perles. Tu enfilais une à une des sonorités qui formaient, associées les unes aux autres, de jolis morceaux de musique. Tu vivais ta vie à cent à l’heure. Le week-end breton semblait avoir eu lieu il y a une éternité alors que quelques jours seulement avaient passé et j’avais mal vécu ce retour à la terre ferme, loin de cette pause que nous avions fait toutes les deux. Ta vie reprenais son cours, un peu sinueux, un peu fou, jamais très droit mais qui te passionnait tellement.
De loin on pourrait croire à une grande tirade, une belle déclaration d’amour, telle qu’on ne voit plus. De loin, ça ressemblait à ce que font les amoureuses quand elles s’aiment beaucoup trop fort. De près, j’étais simplement là et toi aussi. C’était fluide, c’était simple, c’était juste évident. Nous étions rentrées en voiture le dimanche soir, loin de considérer que dimanche était un bon jour pour rentrer mais avions-nous le choix ? La foule de parisiens sur le périphérique m’avait donné cet urticaire, caractéristique d’un blues de veille du lundi, exacerbé par ce week-end passé à regarder l’océan et à rire sur nos vies qui allaient se séparer, les larmes coincées au fond de nos gorges. Rien de très méchant, rien de nostalgique, beaucoup de « comment vais-je faire sans toi une fois que tu seras partie ? ». Tu me répondais que j’avais une famille, que je délaissais en ce moment et que mes enfants m’attendaient certainement quand je ne venais pas les chercher à la sortie de l’école. « Ils t’attendent pas seulement physiquement. Ils t’attendent aussi dans leurs têtes. Ils pensent peut-être que tu ne reviendras pas, que tu les as oubliés à vie. » Je n’aimais pas ta façon de dire les choses crûment, comme ça. Oui peut-être que mes enfants ne comprenaient pas la manière dont je m’occupais d’eux ces derniers temps. Mais j’en perdais la tête aussi. À force. Et puis toi aussi. Tu avais abandonné les tiens. On avait bu, on avait mangé, on avait ri aussi. Ces deux jours loin de tout m’avaient fait le bien que je cherchais dans le lit des autres. Et puis toi aussi.
J’avais ramené les enfants chez leur père après l’école et avais été directement dans le parc te chercher, perchée sur ton banc. Ma fille m’avait parlé quelques minutes dans la voiture, je n’avais pas écouté, je ne parvenais pas à l’entendre, ses phrases n’arrivaient pas à mon cerveau. Tu étais déjà assise à brasser de l’air avec un monsieur à côté de toi. Il ne manquait qu’un pigeon à vos pieds et le tableau aurait pu être complet. Je ne pouvais pas savoir de quoi tu lui parlais mais il buvait tes paroles, comme moi je pouvais le faire et comme tous les autres aussi. On avait des choses à faire et je n’étais pas en avance, tant pis pour les excès de vitesse dans les rues de Paris même si tu avais horreur de ça. « Il vaut mieux arriver en vie qu’à moitié mort sur un brancard », tu disais.
Je t’ai fait signe, de loin, pour que tu me rejoignes et en moins de trente secondes tu as quitté le vieux monsieur sur votre banc, je t’ai serrée contre moi. Avant d’aller vérifier l’état de ton cerveau.
Dans la voiture tu n’as pas arrêté de critiquer l’homme que j’avais quitté quelques mois plus tôt, pour des raisons qui te paraissaient obscures mais qui n’étaient que clarté chez moi. Tu n’appréciais pas ce que j’avais vécu avec cet homme empêtré dans ses contradictions. « Peut-être qu’il n’aime pas tes enfants, mais sinon à quoi bon s’acharner à vivre avec quelqu’un d’aussi égoïste ? Combien de fois Emma m’a dit qu’elle n’aimait pas ce type ? ». Emma a quatre ans et ne peut pas décider pour moi de ce que je dois faire ou pas et qui je dois aimer ou pas. C’est un autre problème que ça, autre chose que son aversion pour mes enfants, ça n’a rien à voir j’essayais de t’expliquer. « Alors il est juste trop con » tu as répondu. J’ai souri. Parce que tu avais raison dans le fond. Le rire d’Emma était trop cristallin et trop enfantin pour être la cause de nos malheurs. « Passe à autre chose, sérieusement, retrouve ton équilibre d’abord, mais passe à autre chose. Tu as les enfants, un boulot, un appartement plutôt sympa. Je ne vois pas pourquoi tu te forcerais à être malheureuse avec lui. Si Emma avait été la cause de vos problèmes, la laisser chez son père aurait été une solution. Vous avez essayé, ça n’a pas marché. CQFD ». Ta clairvoyance m’agaçait, c’était pénible parce que l’esprit radical dans lequel tu évoluais te permettait de faire glisser sur toi ce qui pouvait t’atteindre et au premier rang des problématiques, les ruptures sèches passaient comme l’attachement était arrivé : bien vite. Je ne fonctionnais pas comme toi, mais alors vraiment pas. « Tu es un peu attachiante parfois », je t’avais dit alors que nous arrivions sur le parking de l’hôpital. « Pas qu’un peu ! Mais je suis comme ça. On m’accepte ou pas mais je suis comme ça ». Tu n’avais pas regardé la vitesse du compteur de la voiture et c’était tant mieux.
En descendant, j’ai regardé l’heure, nous avions deux heures devant nous avant que je ne sois en retard pour aller chercher les enfants chez leur père. Pas plus de trois heures m’avait-il précisé, il attendait sa nouvelle compagne pour diner et ne voulait pas gérer les enfants quand elle arriverait. Finalement, les petits étaient trimballés d’une demie famille à l’autre sans que jamais ni lui ni moi ne montrions un attachement assez fort pour qu’ils ne passent pas après le reste. C’est triste j’ai pensé. Je t’ai laissée aux admissions dans le hall pour fumer dehors, près du panneau « hôpital sans tabac » et tu es revenue rapidement vers moi avec tes étiquettes autocollantes à fixer sur le dossier du service radio. « On va attendre là-bas », tu as dit en montrant du doigt une salle pleine de néons au plafond. C’était la première fois que je remettais les pieds dans un hôpital après la mort de mon grand-père. C’était temporellement très loin. Nous nous sommes assises. Aucune de nous deux n’avait le coeur à parler. Tu avais une peur qui remontait dans tes yeux. Je t’ai serré la main. Tu t’es allongée sur mes genoux et tu as fait mine de dormir en attendant qu’on t’appelle. Le temps s’était étiré, les minutes n’avaient plus de sens. Je n’avais pas envie, égoïstement, d’être là. Ce que j’ai pensé là, à ce moment là, c’est que je n’aurais jamais voulu te connaitre, pour ne pas avoir à vivre cette attente-là, avec toi, je l’ai regretté aussitôt pensé. C’était ma façon à moi de me défendre, pardonne-moi.
Les patients comme toi attendaient leur tour, les uns lisant les magazines datés posés près de nous, les autres jouant avec leur téléphone. On captait la 3G, j’avais vérifié. J’aurais bien tweeté, mais quoi ? Qu’est ce que j’aurais pu raconter de notre attente, qui aurait pu comprendre ce que nous vivions et surtout comme préserver le fait que tu abhorrais les réseaux sociaux sous toutes leurs formes ? J’avais bien essayé de t’initier à Instagram, « pour l’instant » j’argumentais, pour le partage des moments, mais tu m’avais rétorqué que ces moments nous appartenaient à l’une et à l’autre et que rien ne justifiait que j’en fasse partager mes 159 « amis » sur Instagram. Alors je suis restée bloquée avec le téléphone à la main, à lire les courts messages de gens que je suivais. J’avais pourtant envie de leur dire. De leur expliquer. Je n’aurais que parlé dans le vide.
Et puis l’infirmière a fini par t’appeler et tu t’es glissée dans une autre salle pour être perfusée. J’avais l’impression que tu avais disparu et que nous ne nous reverrions jamais. J’ai appelé le père de mes enfants.
—
À l’origine de ce texte, il y a ce texte-là. Finalement, comme les idées sont venues les unes à la suite des autres, le tout deviendra quelque chose de plus long. Ou peut-être pas.
Les jeux de plage
Elle a pris cette serviette, toujours la même depuis cinq ans qu’elle vient ici. L’endroit ne bouge pas, pas plus que les rares vacanciers qui tous les ans repeuplent le coin. Des dunes et du sable, quelques pins et une plage qui n’en finit pas. Dans son sac, quelques magazines futiles puisqu’elle ne sait pas lire autre chose que les conseils beauté et mode. Des témoignages peut-être mais la vie des gens l’ennuie profondément. De la crème solaire aussi, un petit indice seulement, histoire de se dire qu’elle conserve un peu de capital solaire pour les jours et les ans à venir, et même si l’indice en question est trop faible. L’important c’est qu’elle puisse avoir cette marque délicate du maillot de bain, autour du cou, et qu’elle montre ostensiblement son passage près de l’océan.
Un stylo et des cartes qu’elle écrira le dernier jour, un signe d’amitié et d’amour sororal penseront les destinataires, la simple preuve qu’elle est partie et qu’ils sont retournés dans le camping triste et glauque de leur enfance pensera-t-elle. À la simple évocation du mot camping, elle frissonne. Les soirées d’accueil, la boom des enfants, la piscine collective et l’odeur des frites et des sardines grillées de la tente d’à côté, tout ça lui donne des nausées. Elle aime le confort de son petit appartement acheté seule, à crédit sur vingt ans « parce que le taux est intéressant » lui a dit son banquier. Elle apprécie aussi la tranquillité du voisinage. L’été dernier, les voisins étaient venus avec leur chien. Attaché toute la journée, il pleurait et faisait le tour du jardin avec sa laisse, le tout petit jardin. Un labrador sable. Elle avait fini par descendre leur dire. C’est pas humain de laisser un animal tout seul tout le temps leur avait-elle sèchement souligné. En réalité, elle voulait juste qu’il arrête de geindre et de perturber le calme du bord de mer.
Elle avançait sur le sable, se brûlant les pieds à chaque pas ou presque. On ne met pas de sandales l’été, au risque d’avoir de sales traces sur le dos des pieds. Encore quelques mètres et elle pourrait poser sa serviette, prune avec un petit logo orange en bas. Cette année encore, elle ne changerait pas de place, son petit ilot de plaisir, entre deux rochers et loin des autres serviettes, habitées par des familles et des couples. Depuis cet endroit, elle était bien assez près pour les regarder et bien assez loin pour ne pas être vue. Encore une année où elle partait seule. En descendant du train, elle s’était risquée à penser qu’elle aurait pu inviter quelques amis, l’appartement était grand et pouvait permettre à cinq ou six personnes de vivre, un peu tassées mais cinq ou six personnes quand même. Et puis elle avait fait rapidement le tour des connaissances qui pouvaient accepter. Elle n’en avait pas. Personne de suffisamment proche à qui proposer une quinzaine à la mer. Personne avec qui elle se sentait de vivre plus de trois jours. Il y avait bien sa soeur, mais ce camping lui collait à la peau. Et puis elle avait deux enfants en bas âge, c’est l’horreur pour les vacances avait-elle songé. Non seule c’était très bien. Pas de compte à rendre, pas de sourires à faire, pas de courbettes non plus. Pas de « tu veux quoi pour le petit déjeuner ? », pas de « vous voulez faire quoi ce soir ? « . Une belle solitude peut-être mais ça lui suffisait. La compagnie des autres pouvait devenir assez vite pénible.
À mesure qu’elle approchait de la mer, elle se sentait de plus en plus légère : la place sur laquelle elle s’allongeait lui permettait chaque jour d’observer d’abord les uns et les autres, puis intérieurement les critiquer – il n’y avait que la plage et les tenues légères pour décomplexer – détailler la plastique de ses voisines aux seins nus et marqués par les deux grossesses qu’elles avaient fait subir à leurs corps, le ventre des maris, bedonnants, à l’image de la vie d’opulence qu’ils devaient mener avec leur 4*4 et leur maison en banlieue. Peu de gamins par ici ou en très bas âge, comme ça, pas de risque de tomber nez à nez avec un parasol qui héberge la prunelle des yeux de ses parents. Il n’y avait pour elle rien de pire que des parents extasiés devant leur progéniture. Regarder les pères construire des châteaux de sable avec leurs enfants lui rappelait combien elle était bien tout seule, loin des préoccupations enfantines et des couches à changer. On lui disait parfois qu’elle n’était qu’un monstre d’égoïsme, c’est sa soeur qui s’était permise de lui faire remarquer qu’elle n’était guère normale à ne vouloir ni mari ni enfant. En réalité elle était bien trop pénible pour être supportée. Elle n’aimait que la compagnie d’un amant ou deux la semaine, parfois le week-end mais rarement. Alors de là à penser être en couple régulier et partir en vacances à deux…
Elle étalait délicatement sa serviette pour éviter que des grains ne s’y glissent quand elle aperçut deux petites filles main dans la main qui marchaient sur le sable, la plus grande avait les chaussures de la plus jeune à la main. Elles chantonnaient une comptine qu’elle ne connaissait pas, quelque chose qui disait « à un à deux à trois on saute, à trois à quatre à cinq on court ». Un truc sans sens, un peu comme toutes les comptines dont elle avait le souvenir. Ou était-ce le souvenir qui rendaient les chansonnettes vides de logique ? Elle espérait que les fillettes s’en iraient bien vite mais au moment de sortir le magazine de l’été – un peu à la con, certes – elle comprit que la plus jeune pensait avoir trouvé le meilleur coin pour creuser un trou et aidée de la plus grande, elle avait attrapé la pelle. Son maillot de main deux pièces était trop grand pour elle et sa poitrine inexistante n’était plus recouverte par les triangles du haut, remontés vers son cou. Les petits noeuds rose du bas tenaient encore, par on ne sait quel miracle. La plus grande devait avoir cinq ou six ans. Elles avaient toutes les deux les mêmes couettes sur le côté de la tête, attachées avec des rubans rose comme leurs maillots de bain. Elles en étaient presque touchantes. Elle s’allongea sur sa serviette prune et oublia les fillettes quelques minutes, les yeux fermés, face au soleil, les paumes des mains posées bien à plat sur le sable et les jambes à peine écartées pour bronzer aussi l’intérieur des cuisses. On ne pense jamais à l’intérieur des cuisses. À tort. La musique dans les oreilles, elle n’entendit pas les petites qui s’étaient rapprochées pour jouer. Une tape sur l’épaule l’avait tirée de son monde. Elle avait senti le sol vibrer mais n’avait pas fait le rapprochement et avait pensé à quelqu’un qui passait près d’elle seulement. Elle ouvrit les yeux, la petite était presque collée à son visage et elle eut un mouvement de recul.
« Tu viens jouer avec nous ? » lui demanda la gamine.
« Euh … je me repose là. Ta maman ne t’a jamais dit qu’il ne fallait pas parler à des gens que tu ne connais pas ? »
« Si mais juste à des garçons » répondit la petite.
« Tu devrais faire attention à tout le monde. Je pourrais être aussi méchante », dit-elle.
La gamine recula de quelques centimètres, abasourdie, elle ne comprenait pas qu’elle ne veuille pas jouer avec elles.
« T’as l’air gentille mais je veux plus jouer avec toi, t’avais qu’à dire oui tout de suite » conclut la petite.
« Viens-là, tu parles à qui ? » cria sa soeur qui jouait toujours un peu plus haut.
« À la dame. Elle veux pas jouer avec nous », répondit sa soeur en courant vers elle.
Elle était gênée de ne pas être sympa avec les enfants. Ils n’y pouvaient rien. Enfin elles n’y pouvaient rien. Parfois elle se posait la question de l’origine de son aversion et puis elle laissait tomber. À quoi bon aller chercher pourquoi alors qu’elle n’avait pas dans sa vie des raisons qui rendait obligatoire la réflexion sur le sujet « pour ou contre les enfants ». Elle était égoïste, point. Elle les observait du coin de l’oeil, ne parvenant plus à dormir avec cette présence, plutôt joyeuse et bruyante. La petite avait déjà oublié la dame gentille mais qui avait refusé sa charmante invitation et elle traçait des coeurs dans le sable. Sa soeur la regardait faire avec un air d’inspecteur des travaux finis, les poings sur les hanches. Finalement, elle les trouvait touchantes de sincérité, dans leurs maillots de bain avec des noeuds roses. Après tout elles ne faisaient que vivre. Un peu comme si elles ne savaient pas ce que c’était de grandir et de souffrir. Elle ne pouvait que s’attendrir en les regardant jouer.
Elle prit son magazine et retourna à sa lecture.
Face à la mer

Ici, c’est le pays du surf

Survivre à un voyage en train
Une pause de garce
Le bruit du vent, les yeux grands ouverts, l’odeur de l’air frais, le reste et cette sensation que tout s’arrête, le temps, la vie et le monde. Il est grand temps de prendre ces minutes, de les avaler pour soi et de les conserver bien au chaud, aussi égoïstement que possible. Vacances, je laisse ici ce que je ne veux pas prendre avec moi, j’abandonne monts et merveilles de ce rythme si chèrement acquis au fil des ans et mets de côté les nombreux moments de partage aussi enrichissants soient-ils. Tu ne sais pas combien je suis légère sur les galets et le sable, tu ne sais pas non plus comme il m’est simple d’oublier que j’ai un toit, une famille, des frères et soeurs le temps de quelques jours.
Toi aussi, là-bas, tu ne sais pas à quel point je me sens forte de ça. Et toi en face, tu lis un truc, affalé sur ton siège, on ne se connait pas. Tu ne peux voir à quel point les mots n’ont aucune emprise sur moi ni même ta simple présence. Tu n’existes pas. Vous n’existez pas.
J’aime l’absence de son, la solitude, l’écho que fait ma voix le long des roches qui observent la mer monter avec fracas. J’aime aussi les files de voitures le long de la côte, remplies de familles qui n’ont d’autres objectifs que celui de laisser leurs serviettes côte à côte. J’attends le moment où je pourrais aller acheter un sorbet au camion qui jouxte le magasin de crocodiles gonflables. Tout ça, aucun d’entre vous ne le sait. Tant mieux, ça ne regarde finalement que moi. Je n’aime pas les pères qui ne jouent pas avec leurs enfants et abandonnent leur progéniture pour lire sous le parasol alors que les mômes n’attendent que lui pour avancer dans leur gigantesque projet de construction d’un château de sable. Je n’aime pas non plus la crème solaire qui laisse des marques blanches quand on sort de l’eau.
Des congés, j’abandonne ce qu’il me reste de ville pour m’enfuir sous un soleil de plombs, un air différent d’ici, des rires qu’on entend plus, de la simplicité qui manque, de la spontanéité perdue des interlocuteurs. Tu ne sais pas tout ça et je ne te le dirai pas. Tu n’es qu’un pauvre voyageur triste qui ne sait pas où il va. J’ai cette saveur particulière en bouche, celle des moments où je suis sûre de moi, de qui je suis. Je suis cette femme à la plastique impeccable qui a longtemps lutté pour être physiquement irréprochable, sculptant ce corps, étrangement malléable, me rapportant compliments et compliments, à la pelle. Je vais m’exposer aux regards envieux, simplement vêtue. Et j’emmerderai le monde autant que je peux le faire en ville. Personne ne doit avoir une quelconque emprise sur qui je suis, personne non plus ne peux décider pour moi ce que je fais, où je vais, pourquoi je le fais. Je suis finalement cette garce méprisante, entretenue par un entourage faible et parfois condescendant. La seule chose que tu peux voir de moi, c’est ce mépris.
Je suis descendue du train. En réalité je n’avais qu’une seule peur, celle de ne pas me faire à mon propre silence et à mon propre vide.
Extrait de roman. Clap de fin.
Nous sommes descendu du bus, nos mains toujours séparées et avons parcouru le marché aux fleurs, absents, lointains. Nous devions parler mais aucun de nous n’avais eu la force de prononcer quoi que ce soit. Et puis soudain tout m’a fait de nouveau horreur. Les flics en uniforme, les voitures qui attendaient que le feu passe au vert, le vélo qui roulait à côté du bus, les publicités sur les murs, partout, symbole émétique d’une société de cons qui n’ont aucune autre sommation que celle de leur banquier et l’autorisation de découvert qu’il vous offre gracieusement alors même qu’il fait jouer les dates de valeur de vos chèques. Une inertie nécrosante de ceux qui perdent tout, en silence, doucement. J’ai vomi dans une poubelle et me suis assis sur les marches du palais de justice. Des japonais regardaient l’homme que j’essayais de ne pas devenir, pervertit par les chiffres, la valeur hypothéquée de ma vie. Et cette odeur de mort qui transpirait de tous les gens que croisait mon chemin. Imbibés du matraquage consumériste.
Je me suis relevé. J’ai de nouveau vomi dans la poubelle. À ce moment-là, tu as décidé de te sauver la vie.
[…]
Tu étais assise à côté d’un homme que tu ne reconnaissais plus et je t’en plaignais.
« C’était vomir dans la poubelle ou te couvrir d’insultes. »
Alors tu m’as répondu. Du plus beau monologue qu’on ait pu m’offrir.
« Parce que j’ai oublié de prendre un parapluie ? Pour ça et tout le reste ? Il vaudrait mieux que je parte et que je ne te revois plus jamais. Tu déverses ta haine d’être devenu un type minable, sans envie ni passion, sans joie ni peine. Juste un tas de haine mal dirigée, pétri d’obsessions qui te pourrissent, imbibé d’alcool, d’une violence que je ne connaissais pas encore mais que, crois moi, je vais fuir le plus loin possible. J’avais besoin de toi, souvent, tout le temps. Et puis tu es parti loin de moi, loin de ce qu’on avait vécu, loin de toi. J’avais besoin de ta main dans la salle d’attente, besoin de tes yeux dans les miens. Besoin de toi. Tu n’es pas resté, tu as fui comme chaque chose que tu fais. C’est à mon tour de fuir. Avant que tu ne commettes l’irréparable et que jamais je ne puisse me relever. »
Elle est partie. Je suis resté sur les marches du palais de justice jusqu’à la tombée de la nuit. Et signais un pacte avec ma destruction. Soulagé, j’allais pouvoir mourir de ma lâcheté dans la plus grande solitude possible.
Ceci est l’un des extrait du roman à présent en phase de relecture par deux tiers. Terminé il y a peu, ce chapitre a été écrit il y a presque un an. Pour des raisons que j’ignore et c’est le plus intéressant.
Ta main
Posée sur la mienne, ta main, toute minuscule, sortait de ta manche comme un diable de sa boite. Au bout d’un long poignet, tes doigts fins, manucurés à l’arrache. Petite rockeuse. On ne m’avait jamais dit comme il était possible de s’attacher à une petite femme comme toi. On ne m’avait pas non plus prévenue à quel point il pouvait être difficile de t’écouter parler. De ce que tu avais traversé de vie, de ce qui pouvait faire qu’à présent tu étais plus vivante que les autres. Ton corps sur ce canapé, emmitouflé en cet hiver, apaisé, se soulevant à chaque inspiration et à chaque expiration, montrait de quelle manière il était si simple pour toi de respirer, si naturel d’être allongée, là, sur mes genoux. On avait quoi, dix ans de différence, quinze ? Peu importait en réalité l’âge qu’on avait, nos parcours parlaient pour nos artères. Tu disais souvent qu’on avait pas d’âge mais qu’on avait une histoire. Tu m’as autant apporté que ces années passées à réfléchir sur ce divan en bas de la rue des Dames. Rue des Dames ça te faisais toujours marrer quand on y marchait le soir : on avait jamais croisé une seule prostituée et j’avais beau t’expliquer que le nom de la rue venait de celui d’une abbaye ou d’un monastère, tu ne savais que répondre que jamais nous ne rencontrions de prostituées.
Tu avais l’air plutôt fragile pour une rockeuse. Menue, petite, frêle, légère, autant de qualificatifs qui faisaient de toi quelqu’un de friable au coup d’oeil de politesse. Pourtant il ne me semble pas t’avoir vue pleurer une seule fois, ni même flancher. Tu aurais pu parfois. Mais pleurer ça sert à rien tu disais, sauf à ce que les autres s’apitoient sur ton sort. Et s’il y a bien une chose dont tu avais horreur c’est la condescendance et la pitié. Tout ce qui chez moi au premier regard t’avais séduite. Tu avais largué les amarres, au loin tu avais tout quitté, mari, enfant et appartement, petit confort de ceux qui n’ont d’autre courage que de s’enliser dans une situation qu’ils abhorrent mais qu’ils conservent de peur de. Tu ne jugeais pas les autres, tu constatais seulement ce que tu prenais pour de la lâcheté. Je te répondais que tout le monde n’avait pas ta clairvoyance et que parfois la lâcheté n’était qu’une forme de contentement qui pouvait très bien aller de pair avec le bonheur. « C’est pas mon bonheur » tu répondais. « C’est quoi le bonheur d’ailleurs ? C’est quelque chose que tu ne peux pas saisir tant que tu n’as pas ressenti la perte ou l’abandon. Un truc qui fait que tu avances, tu n’as pas le choix. Ou alors c’est que tu n’as pas le courage d’affronter ton reflet dans le miroir ».
Tes certitudes me fatiguaient parfois, souvent, parce que tu n’essayais pas de comprendre que ce avec quoi tu t’étais construite pouvait te permettre d’avoir ce luxe là, de saisir en quoi le vent dans tes cheveux avait son importance ou encore marcher à cloche-pieds sur un pont correspondait au privilège de ceux qui ont gouté l’enfermement contre leur docilité. Tu étais comme une chose un peu fragile qui virevoltait encore alors que la tempête sévissait dehors et faisait claquer les volets contre le mur de la maison.
On avait quitté Paris pour le calme des falaises bretonnes en ce week-end. Tu avais ce besoin viscéral de penser que les embruns avaient parcouru beaucoup de chemin avant d’arriver sur tes lèvres. Tu souriais encore cet après-midi, engoncée dans ce polaire vert fluo. Pour qu’on te repère de loin sur les pierres. On ne pouvait pas te rater. Tu m’avais fait cet aveu d’une fin annoncée. On ne savait ni les semaines ni les mois. On savait juste que ta vie avait une saveur particulière, un gout sucré sur la langue et que la mienne qui s’y ajoutait rendait tes jours heureux. Je n’ai pas pleuré, j’ai eu le souvenir de ce que tu pensais des larmes. Je suis là je t’ai promis.
Sur le canapé, ta petite main manucurée à l’arrache ne bougeait pas. J’essayais de respirer le moins fort possible, pour ne pas troubler ton sommeil du juste. Tes yeux fermés. Le sel qui piquait encore mes joues. Et mon sourire. Je suis là.
Fiat lux.

Jules.
Ce sourire sur ses lèvres, comme le gamin de cinq ans devant son nouveau jouet, signifiait qu’il était d’accord. Il avait dit « oui », il avait accepté l’expérience, sans rechigner. Tout irait bien à présent. C’est de la confiance qui scintillait entre lui et moi, de l’avenir certain, un rayon de soleil et ces valises qu’il allait faire, vidant ses tiroirs, triant ses jeux et ses livres écornés à force d’en avoir tourné les pages. Il est parti s’enfermer dans sa chambre et je sentais le soulagement poindre, là, tout près de la poitrine, ce poids qui allait finalement disparaître. Il n’a pas posé de questions inutiles. Seulement celles pratiques : fallait-il prendre ou non son maillot de bain Spiderman ? Pouvait-il emporter son vieux walkman qui ne fonctionnait plus mais auquel il tient très fort ? Et acheter une nouvelle brosse à dents parce que la sienne il voulait la laisser là, au cas-où ?
J’ai répondu oui à tout. Sans détour. Je n’avais guère le courage de lui avouer ce qu’il allait advenir de sa brosse à dents quand nous serions partis. Encore moins de lui dire que nous n’irions pas nous plus vers la mer. Nous sommes allés chercher des barres de céréales et des bonbons dans le placard de la cuisine, et en montant sur la chaise pour attraper la boite, il a fait tomber un verre. Il s’est brisé en mille morceaux et les éclats se sont glissés sournoisement sous les meubles, la table. Il m’a regardée, inquiet. En réalité, je jubilais : nous ne laissions que la douleur disséminée en nous depuis quelques années, lui offrant ce cadeau sublime du verre qui se cache et qui longtemps restera sous le réfrigérateur, signe de ceux qui partent sans regarder derrière eux et le marasme qu’ils laissent.
Nous allions devenir des vagabonds. J’allais arracher ce petit garçon des bras de son père. Et partais détendue.
Le disque rayé
Il y a ce soleil, indécent, impudique. Entré par la fenêtre. Un rayon frôlant ta hanche gauche. Et cette musique lancinante, comme un prélude à un amour qui n’existe que parce qu’il est là. Les heures s’étirent sans que nous ne puissions y faire quoi que ce soit. Fermer les yeux n’y changerait rien. Les garder ouverts non plus. Ma main glisse sur le drap et recouvre ta hanche avec ce tissu blanc. Il ne fait pas chaud en nous.
Il y a cette mélancolie dans tes yeux. Ce regard qui veut dire « je ne sais pas où on va, je ne sais pas si je te suis par là où tu passes ». Les genoux enroulés dans mes bras, assise sur le lit, il y a ce froid qui traverse chaque pore de ma peau, de l’intérieur vers l’air ambiant. La musique lancinante va d’ici quelques secondes s’arrêter sur une seule note, répétée et répétée. Le disque est rayé, tu le sais. Moi aussi.
Il y a ce qu’il reste de nous. Il y a cette douceur qui ne parvient pas à prendre le large. Cette douleur aussi, d’être pris au piège du risque d’être en vie. D’être entiers. Avec toute l’amertume que ça suppose. Le soleil se lève. Pas nous. Nous sommes figés dans ce qui n’existe pas, nous mentons à la terre entière, et à la clef la peur de l’échec, de ne pas être à la hauteur d’une société qui exige un bonheur constant et aussi linéaire que l’horizon vers l’Angleterre que nous avions aperçu en juillet dernier.
Il y a l’heure qu’il est. Approchant les six heures. Ce mercredi où tout peut basculer vers le pire comme vers le meilleur. Le morceau dans la chaine-hifi essaie de trouver la sortie. Ni toi ni moi ne nous tournons vers la télécommande, hypnotisés tous deux par le surréalisme de la scène. Je te murmure.
Que tu sais, « on ne guérit jamais d’avoir vécu ».
Sur la route

Bien avant les images, Saint Lazare

Parce qu’il pleut

Je me souviendrai

Une soucoupe

Sous serre

Cartes bancaires
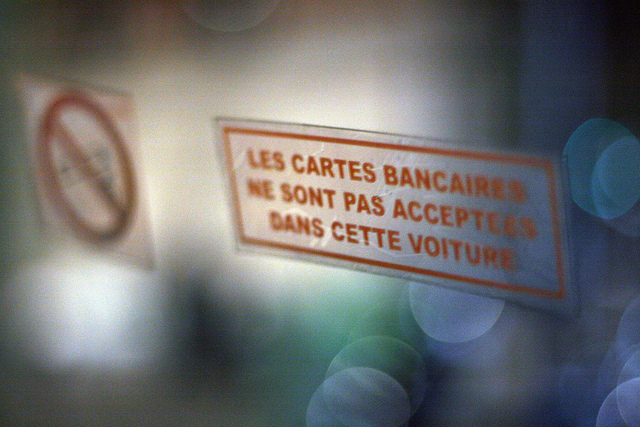
#3
Tu sais pertinemment que je ferai des aller retour dans ta vie jusqu’à n’en plus pouvoir. Que brusquement je sonnerai à ta porte ou que j’appellerai ton répondeur. Tu sais que c’est une sorte de manège, de circuit. Des va et des viens. Et tu saisiras ce que tu veux pour moi. Tu n’oublieras pas. Je ferai en sorte que mon sourire te soit gravé au fond des yeux, que pour les mauvais jours, là, de loin, tu aies l’impression que je sois juste à tes côtés.